Les composantes de notre oreille
• L'oreille est située sur la partie latérale du crâne, dans une partie de l'os temporal appelé le rocher, sous le lobe temporal du cerveau dont elle est séparée par une coque osseuse. Anatomiquement, on distingue 3 parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne.

• L’oreille externe est composée du pavillon, du conduit auditif, et du tympan qui est une fine membrane. L’oreille moyenne, elle, comprend la chaîne des osselets, qui sont les plus petits os du corps humain: le marteau enchâssé dans le tympan, l’enclume, et l’étrier, relié par une autre membrane à la cochlée. Enfin, on trouve dans l’oreille interne la cochlée reliée au nerf auditif et la trompe d’Eustache et le vestibule qui sont une seule et même structure (osseuse et membraneuse).
Le chemin d'un son dans l'oreille
• Au niveau des oreilles externe et moyenne:
Notre pavillon nous permet de capter des sons compris entre 20 et 20000 Hz.
Après avoir fait son chemin dans notre conduit auditif, le son entraîne la vibration du tympan, qui créée une réaction en chaîne des osselets. L’étrier est directement au contact des liquides de l’oreille interne par l’intermédiaire de son socle appelé platine qui en s’enfonçant dans l’oreille interne lors des mouvements de l’étrier mobilise les liquides labyrinthiques. Nous possédons un muscle appelé le muscle strapédien attaché à cet étrier par un petit tendon et qui est relié à une des branche de notre nerf facial. Ce muscle est responsable des fortes intensités d'un réflexe de protection acoustique : le réflexe stapédien (qui permet en se contractant de “rigidifier” la chaîne ossiculaire et d’atténuer les effets nocifs des bruits forts sur l’oreille interne). Autrement dit, lorsque nous contractons les muscles de notre visage, un geste qui peut nous paraître sans réel impact sur notre santé, nous nous protégeons en réalité des sons de trop forte intensité!
• L'oreille interne (OI) ou labyrinthe comprend en fait 2 organes sensoriels : la cochlée (ou labyrinthe antérieur, pour l’audition) et le vestibule (ou labyrinthe postérieur, pour l’équilibre). C’est là que les vibrations solidiennes sont transformées en impulsions électriques pour pouvoir être lues et interprétées par notre cerveau.
(On appelle “sons solidiens” les sons qui se propagent dane la structure d’un “bâtiment”). Comme indiqué précédemment, la cochlée et le vestibule sont formés de deux “labyrinthes”, un osseux et un membraneux, le second situé à l’intérieur du premier.


Les ondes sonores “voyageant” jusqu’à présent dans un milieu aérien, font bouger les osselets, et l’étrier exerce une pression sur la membrane de la fenêtre ovale de la cochlée faisant ainsi pénétrer les ondes dans cette dernière. Si le reste de la cochlée était hermétiquement fermé, l’étrier ne pourrait exercer de pression sur la membrane, cela est rendu possible grâce à une seconde fenêtre, appelée fenêtre ronde, et elle aussi close par une membrane qui peut donc se déformer et autoriser un changement de pression de liquides de la cochlée :

Ces ondes mettent ensuite en mouvement le liquide à l'intérieur de la cochlée, aussi nommé Périlymphe. Elles passent donc dans un milieu aqueux. Le liquide est mis en mouvement à la manière de vagues dans de l’eau. Les ondes hydrauliques se propagent le long de la rampe vestibulaire et exercent une pression sur la membrane de Reissner laquelle entraîne une variation de pression de l’Endolymphe dans le canal cochléaire. Ces variations de pressions de l'Endolymphe dans le canal cochléaire ont un impact sur un organe appelé organe de Corti.

L’itinéraire du son dans l’organe de Corti est certainement la plus délicate et difficile à appréhender.
Cet organe se trouve dans le canal cochléaire, canal situé entre la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. Il est composé principalement de deux membranes, qui bougent de façon relative l’une par rapport à l’autre: la membrane tectoriale et la membrane basilaire, et il contient 2 types de cellules ciliées neuro-sensorielles internes et externes (CCI et CCE), terminées par des stéréocils. Les variations de pressions dans les rampes vestibulaire et tympanique entraînent le mouvement des membranes tectoriale et basilaire. Les stéréocils des CCE étant implantés dans la membrane tectoriale, ils sont déplacés horizontalement (on parle alors de cisaillement) ce qui ouvre les canaux ioniques de ces cellules, laissant pénétrer dans les CCE des cations de potassium (K+), et permettant leur dépolarisation. Cette dépolarisation des CCE rend possible leur contraction puisqu’elle induit un changement des cellules membranaires qui les composent. Ce mécanisme de contraction des cellules a pour rôle l’amplification des vibrations reçues, afin que la membrane basilaire vibre de façon assez forte pour entrer en contact direct avec les CCI (en effet ces dernières ne sont directement stimulées que dans le cas d’un son supérieur à 50dB). Ce mouvement déclenche leur dépolarisation, ce qui rend possible l’envoi d’un message nerveux à travers le nerf auditif jusqu’à notre cerveau.
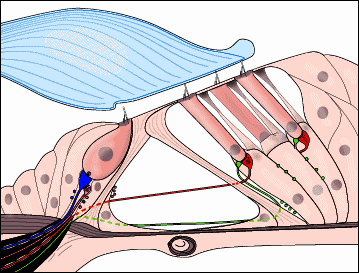
• Après avoir quitté les CCI, les influx nerveux sont donc transmis au nerf auditif , qui va les amener aux centres auditifs du cerveau par le tronc cérébral : les décharges nerveuses passeront par le nerf cochléaire avant d’arriver dans le noyau cochléaire qui commence à déchiffrer le son : il permet de définir son type (cri, alarme, paroles…) puis dans le thalamus où il se fait un important travail d’intégration (préparation d’une réponse motrice ou vocale par exemple). Enfin, les influx sont transmis au lobe temporal, partie du cerveau responsable de l’audition et plus précisément au cortex auditif. Ce dernier recevra donc des informations en grande partie décodées, et il n’aura plus qu’à les reconnaître, voire même les mémoriser.



